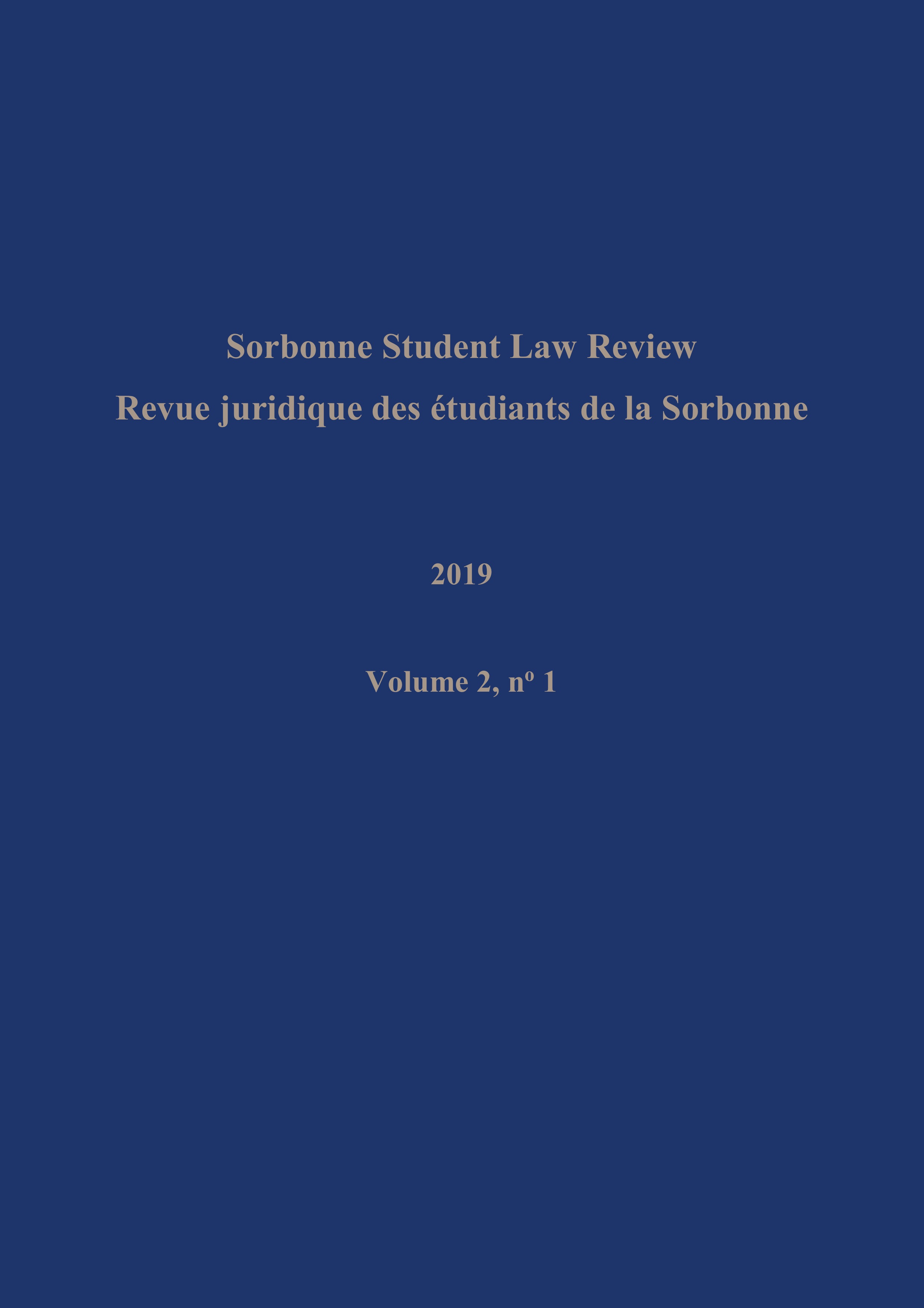Résumé
Au fil d’une multitude de réformes, l’Union s’est fondée sur une structure qui est incomparable à celles des organisations internationales classiques, en ce sens qu’elle possède une nature supranationale, elle est englobée dans un projet impliquant un réaménagement des souverainetés nationales, et, finalement, elle est qualifiée par l’adoption de normes juridiques matérielles uniformes,souvent capables de s’adresser directement aux ressortissants. Ces éléments ont conduit la doctrine des années soixante-dix à conceptualiser l’idée d’intégration dans le sens d’une Communauté des peuples et d’États. Même étant à plusieurs égards encore incomplète, cette idée d’unification des peuples s’est progressivement enrichie d’un noyau de droits fondamentaux. De plus le processus a discrètement acquis un «?système commun des valeurs?» qui vient assumer un rôle primordial dans la jurisprudence très récente de la Cour de justice. J’essaierai de vous proposer un regard structurel sur les traités européens, pour vérifier s’ils contiennent, du moins, les fondements d’une «?communauté de droits et des valeurs?», et non plus simplement d’institutions supranationales ayant la compétence d’établir un droit uniforme?; il s’agit, à mon sens, d’un ensemble de droits et valeurs susceptible de façonner l’esprit de la société européenne afin qu’elle puisse progresser, à terme, vers une communauté plus homogène de peuples. Mais je ne plongerai pas mon regard dans une analyse politique. Ce ne serait pas le métier d’un juriste. La perspective que je vous propose est exclusivement juridique et vise à montrer certains points cardinaux du système juridique de l’Union tel qu’il a évolué à la suite de la réforme de Lisbonne et de la jurisprudence de la Cour de justice.